Crèche et école
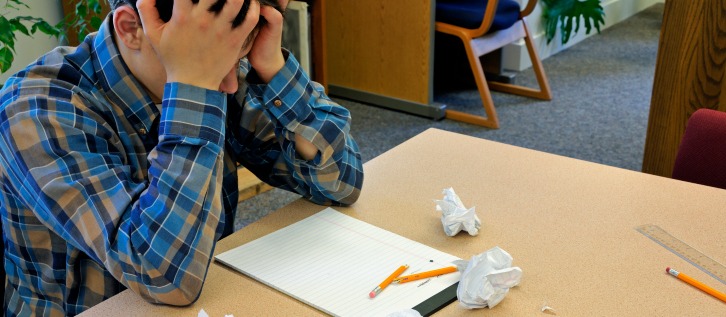
Le parcours scolaire, une course de fond. Certains en sortent harassés. Il peut laisser des séquelles qu’il est important de prendre en compte. Une étude vient de sortir à propos des impacts du redoublement dans le secondaire, sur le supérieur. Mais il n'est pas le seul à marquer. Nous avons rencontré quelques jeunes aux histoires différentes qui reviennent sur les épreuves qu'ils ont vécues.
Ce n'est pas neuf, la Belgique est championne du redoublement. Selon la dernière étude de l'OCDE, 46 % des élèves accèdent au supérieur en ayant redoublé au moins une fois. Une étude mesure son impact sur le moral des élèves une fois entrés dans le supérieur. Les conclusions menées par Jean-Paul Lambert, recteur honoraire de l'université Saint-Louis à Bruxelles, dressent le lien entre le redoublement et la réussite à l'université. Un étudiant qui a du retard scolaire dans le supérieur a seulement 25 % de chances de passer en deuxième sans encombre. Le redoublement n'est pas le seul facteur qui fait jeter l'éponge aux étudiants. Cette étude fait écho aux propos d'étudiants cabossés qui se sont livrés au Ligueur sur leurs parcours difficiles et leurs répercussions.
Comme sur des rails
Nous commençons avec Pier, aujourd’hui étudiant en 2e année à La Cambre. Le jeune homme de 21 ans paraît bien dans ses baskets. Mais lorsqu’il revient sur son parcours scolaire, il s’assombrit.
« Avec le recul, je peux dire que j’étais perdu. Du plus loin que je me souvienne, l’école ne m’a jamais plu. Je comptais les années à y passer et ça me déprimait. J’avais l’impression d’être sur des rails et de ne pas pouvoir m’en arracher. J’y suis resté pour faire plaisir à mes parents, notamment parce que mon père n’a jamais fait d’études. Aujourd’hui, je suis étudiant en art. Je me consacre à fond à ma discipline et je me jure à partir de maintenant de vivre ma vie comme je l’entends, sans me contraindre. »
Laurent Belhomme, responsable de PsyCampus à l'ULB, reçoit ces élèves à bout de souffle, une fois qu’ils intègrent l’université. Son service est saturé. Que lui disent ces jeunes gens ? « Ils ont souvent le sentiment d’être pris dans un système qui ne leur convient pas. L’entrée dans le cycle supérieur suppose que l’on sorte de l’adolescence, c’est-à-dire de suffisamment se connaitre pour pouvoir poser des choix. Mais la société a plus tendance à nous dire ‘ceci te rendra heureux’ ou ‘tout le monde veut cela’ que de nous aider à réfléchir à notre spécificité. Je pense que, pour beaucoup d’entre eux, le problème c’est de vouloir correspondre à un modèle. En fait, j’ai le sentiment que beaucoup de jeunes réalisent à la fin du parcours secondaire que la réussite sociale n’est pas toujours liée à l’accomplissement personnel. Et peut-être qu’en tant que parents, ce n’est pas mal d’expliquer ce genre de nuances. »
Une question essentielle se pose alors : l’école forme des citoyens, mais permet-elle aux plus tourmentés de se trouver ? Est-ce son rôle, d’ailleurs ?
L’école ne m’a pas permis de me construire
Se trouver une place dans la société, d’accord. Se préparer au monde du travail, très bien. Qu’en est-il de son propre épanouissement ? « Je ne pense pas que ce soit le rôle de l’école », affirme Olivia, 20 ans, qui s’accorde un peu de temps. Après une carrière scolaire exemplaire, la jeune fille a tout lâché.
« J’ai été admise dans le sud de la France à Sciences Po, j’étais entourée de jeunes requins, très, très cons, et ça m’a renvoyé à la figure que je ne m’étais jamais posée de question sur ma place dans le monde. Je ne veux pas rentrer dans ce jeu. Pourquoi je ne marche pas sur la tête de mon voisin pour servir mes ambitions personnelles comme les autres ? Il faut que je trouve la réponse. »
Aujourd’hui, Olivia veut être en prise avec la réalité du monde du travail. Elle cumule différents petits jobs et entreprend de longs voyages. Elle a besoin de se trouver, elle qui a l’impression de s’être mise entre parenthèses durant toutes ces années. Laurent Belhomme nous rappelle que les valeurs de réussite ou de concurrence véhiculées de différentes façons peuvent affecter les jeunes.
« Beaucoup sont pris dans des paradoxes et n’agissent qu’en fonction de ce que l’on attend d’eux. Attention, ceux qui sont dans la compétition ne sont pas d’affreux humains sans cœur. Cela peut être un exercice très compliqué pour eux. Ils vivent une vie en mosaïque. Quel est le fil qui relie tout ceci ? Ce n’est pas toujours évident à trouver. Il est peut-être intéressant d’en être conscient en tant que parents ou professeurs ». Ce qui nous amène à la question de la différence à l’école.
Des sensibilités multiples
L’originalité, la marginalité ou la simple différence liée à une question de handicap ou même de sensibilité n’ont pas toujours leur place dans la cours de récré. Deux élèves nous racontent le calvaire de l’exclusion. Mike, aujourd’hui jeune professeur, est en situation de léger handicap moteur. Sa démarche a été un sujet de moquerie tout au long de sa scolarité.
« J’aime l’école et je l’ai toujours aimée. C’est pourquoi je fais ce métier aujourd’hui. J’incite les élèves à accepter toutes les différences. J’ai grandi dans une petite ville dans laquelle la norme était de mise. Je vous passe le nombre de fois où mes petits camarades marchaient derrière moi en m’imitant pour se foutre de moi. Heureusement, j’évolue dans un cadre familial très solide qui m’a aidé à prendre du recul. »
Pour Jacques, élève en rétho, tout s’est joué autour de la question de l’identité sexuelle. « Je suis le pédé de service dans un établissement très dur. Je poste des photos de moi très suggestives sur Facebook, et ça choque. J’ai été frappé pendant un cours. J’ai été menacé de mort. Je compte beaucoup sur l’université pour rencontrer des gens plus ouverts. Ma grande force, c’est quelques amis plus intelligents que la moyenne et un prof gay qui m’a raconté son adolescence. À côté de lui, je n’ai pas trop à me plaindre. »
En dépit d’un témoignage fort, Jacques vit très mal ce contexte. Il est en situation d’échec scolaire. Il cumule donc deux facteurs d’exclusion très sérieux. Laurent Belhomme analyse : « Ce que je trouve rageant, c’est le fait que des élèves puissent sortir amochés du secondaire uniquement parce qu’ils ne sont pas dans la norme. Dans ce témoignage, on voit bien que la souffrance n’est pas liée à la nature de la différence mais plutôt à la stigmatisation qu’elle provoque. Dans ce cas, c’est clair, mais, c’est une distinction importante à laquelle il faut toujours être attentif. Dans ces situations il faut tenter de rassurer l’enfant sur sa valeur, lui dire que ce n’est pas lui qui a un problème. Mais aussi essayer de lui permettre de rencontrer des personnes qui l’acceptent et avec lesquels il pourra établir des liens gratifiants. » Pour le psychologue, l’école devrait prendre en compte la sensibilité de chacun et en tenir compte dans la vie en groupe.
Harcelée pendant des années
On termine avec le témoignage de Lucille. La jeune fille de 23 ans vient d’un milieu très protégé, ce qui n’a pas empêché ses parents de ne pas voir le drame qui se déroulait tous les jours sous leurs yeux. Dès les premières années du secondaire, elle se dispute avec sa meilleure amie de l’époque. Sans vraiment de raison. Elle se fait pirater ses comptes web, se fait suivre dans la rue par des inconnus qui la menacent par son prénom. Toute sa classe est contre elle. Elle retrouve des messages insultants dans les toilettes.
« Je me suis sentie piégée pendant des années entières, comme dans une impasse. Je voulais disparaître loin de ce quotidien écœurant ». Elle n’en parle à personne. Quelques années plus tard, elle développe des troubles alimentaires que les adultes autour d’elle associent à sa croissance. Lucille est seule. Jusqu’au jour où un voisin la voit tomber en larmes dans la rue et l’invite à boire un café. À partir de ce moment, la jeune fille se met à parler.
« Je réalise avec le recul que ce n’est pas normal de lutter seule. J’avais peur qu’on ne me croit pas. À présent, je n’ai qu’un seul rêve : faire payer ces longues années de galère à cette fille qui m’a fait tant de mal. Je serai en paix une fois que cette envie de vengeance aveugle me sera passée. J’en veux à tous mes professeurs de n’avoir rien vu, de n’avoir rien dit. J’ai encore beaucoup de rancœur. Beaucoup trop. »
Nous profitons de ce témoignage pour rappeler les recommandations de Pascal Vekemans, médiateur scolaire : « Quand un père ou une mère intervient, il ou elle fait face à un mammouth. L’école est à la fois juge et partie. Non entendu par un titulaire, le parent ne peut que s’adresser à un préfet de discipline, un directeur, un pouvoir organisateur. »
Pour instaurer un réel dialogue, le spécialiste prône le recours systématique à une aide extérieure à l’école. Laurent Belhomme élargit la question à la quête d’identité qu’il cible comme le problème à la source. « J’aimerais que l’on explique aux jeunes que se construire, c’est un processus. C’est un peu comme se muscler, ou garder la forme : il faut pratiquer, et les résultats apparaissent progressivement. Aidons-les à se forger une identité spécifique, et à ne pas adopter un modèle préfabriqué. Le chemin sera plus long, ils vont devoir s’édifier petit à petit, à la main. Et même s’ils choisissent un modèle dans la norme une fois adultes, ils y seront arrivés par eux-mêmes. Aux jeunes : ne laissez pas les autres vous dire qui vous êtes. Ni vos parents, ni vos profs, ni tout autre prescripteur. Ne vous laissez pas construire par un cadre. »
À LIRE AUSSI

