Loisirs et culture
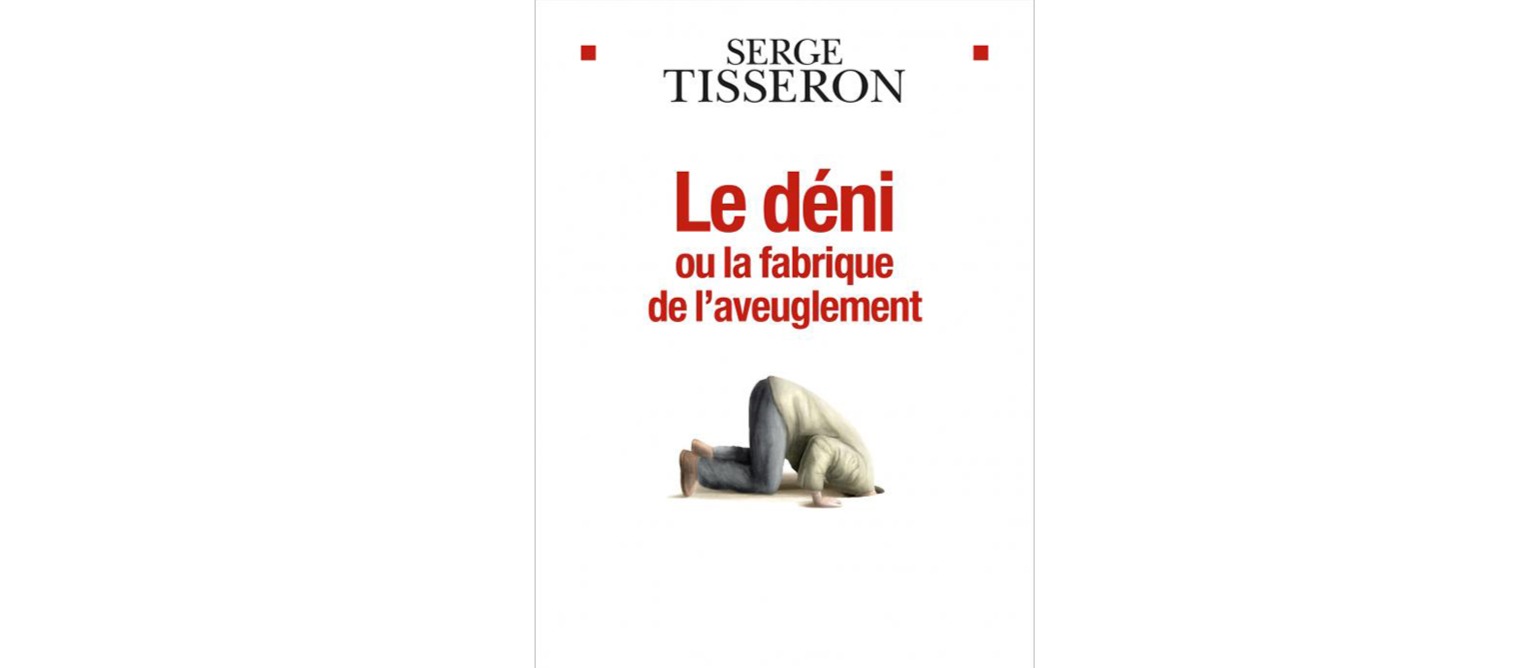
Déni de la pandémie, déni des dérèglements climatiques, déni de la guerre en Ukraine… Et autant de dénis qui font le lit de théories du complot. En ces temps de crises, le mot est partout. « Serions-nous tous atteints par le syndrome de l’autruche, cet animal dont la légende raconte qu’il se plonge la tête dans le sable afin d’ignorer ce qui l’inquiète ? », questionne le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron dans son captivant Le déni ou la fabrique de l’aveuglement (Albin Michel).
L’essai est dense. Le concept, au cœur de notre vie psychique et sociale, est complexe. Impossible de tout évoquer ici. Soulignons que le déni peut prendre diverses formes. Ainsi, en tant que moyen de se protéger contre un traumatisme (décès brutal d’un proche, abus sexuel…), il est un processus très utile, « mais celui qui est dans le déni d’un traumatisme reste toujours habité par le désir de pouvoir le dépasser un jour ». Le déni devient problématique lorsqu’il s’installe durablement au sein d’une personnalité ou d’un groupe.
Insistons aussi sur les moyens de limiter les dénis : « La prévention de la propagation des dénis passe à la fois par une meilleure sensibilité de chacun au point de vue d’autrui, mais aussi par une meilleure acceptation de la multiplicité des points de vue à l’intérieur de soi ». D’où cette attention spéciale aux enfants : « Encourageons chez eux le goût du débat et de la controverse et la capacité d’envisager tous les points de vue possibles face à une situation complexe ». Sans oublier une éducation précoce aux pièges d’internet.
À LIRE AUSSI


