Crèche et école
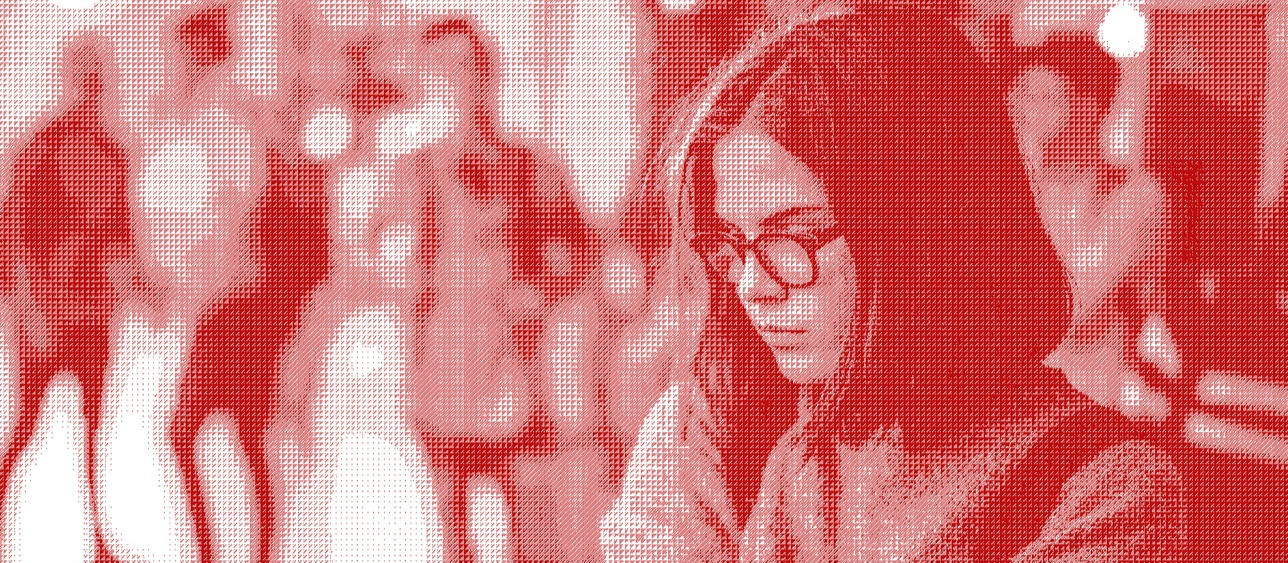
Le harcèlement fait l’objet de nombreuses idées reçues. Heureusement, il est aussi au centre d’études qui améliorent sa compréhension. À partir du livre* de Benoît Galand, qui fait le point sur les savoirs accumulés, passons au crible les mythes et réalités du harcèlement scolaire.
La prévention diminue le harcèlement
La prévention permet de diminuer d’environ 20% les situations de harcèlement. Elle est indispensable, mais ne permet pas d’éradiquer le phénomène. Attention, toutefois, que toutes les actions préventives ne sont pas efficaces.
Il existe un profil type de victime
Ce n’est pas vrai. En revanche, il existe des facteurs de risque qui augmentent la probabilité d’en être la cible. Les élèves porteurs d’un handicap visible, qui présentent des problèmes de santé mentale, qui ont une orientation sexuelle minoritaire ou qui sont en surpoids sont plus à risque que d’autres.
Les auteurs de harcèlement manquent d'empathie
Discours largement véhiculé, mais erroné. Deux profils types d’auteur·es se dégagent. Dans une minorité de cas, il s’agit d’élèves en souffrance qui présentent des comportements agressifs et impulsifs. Mais la plupart du temps, le harcèlement est un comportement stratégique motivé par la recherche d’une position dominante qui ne résulte pas d’un manque d’empathie ou de difficultés à exprimer ses émotions.
La médiation n'est pas recommandée
La technique de médiation peut être recommandée en cas de conflit, mais pas pour du harcèlement. Cela peut même être délétère de confronter victime et auteur·e étant donné l’asymétrie de pouvoir.
La sanction limite efficacement le harcèlement
La sanction risque de rendre le harcèlement encore plus pernicieux. Elle peut être réparatrice pour la victime et une manière pour l’école de réaffirmer ce qui est autorisé ou non, mais elle doit s’accompagner d’autres mesures.
Le harcèlement est un phénomène ordinaire commun à toutes les écoles
À partir du moment où les élèves ne se choisissent pas, partagent des territoires tout en y subissant des contraintes, il est « normal » que des situations de harcèlement se produisent. Toutes les écoles sont concernées.
Une méthode permet aux écoles d'intervenir rapidement
La recherche scientifique et les expériences de terrain démontrent qu’il n’y a pas de recette miracle. Ce serait même préjudiciable de plaquer une formule prête à l’emploi à toute situation de harcèlement. La stratégie est à construire au cas par cas.
* Le harcèlement à l’école. Mythes et réalités, Benoît Galand, (Retz, 2021).
Le regard de
David Plisnier, coordinateur du Centre de référence et d’intervention harcèlement (CRIH), sur les différentes approches
La méthode de préoccupation partagée (PIKAS) : « L’université de Versailles a suivi plus de 1 000 cas de harcèlement et démontré que PIKAS fonctionnait dans 80% des cas ».
KiVa : « Ce programme a fait l’objet de plusieurs évaluations et démontré son efficacité sur le plan international. En Finlande, cela fait dix ans qu’il a fait ses preuves. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a plus de harcèlement. L’artillerie mise en place est énorme, deux ans de formation des enseignant·es, vingt heures par an de sensibilisation des élèves. Pour avoir l’équivalent en Belgique, il faudrait 3 500 équivalents temps plein ».
La thérapie brève systémique et stratégique de Palo Alto : « Travailler l’assertivité de la victime pour qu’elle change de posture demande beaucoup de ressources, toutes les victimes n’en sont pas capables. Cette approche peut s’envisager comme une psychothérapie auprès de la victime a posteriori. Pour l’intervention suite à du harcèlement, nous privilégions des approches qui travaillent sur la dynamique de groupe. De la même manière, nous ne misons pas sur des approches qui ne travaillent qu’avec le harceleur ou la harceleuse ».
Le mot de la fin
Benoît Galand : « L’enjeu, aujourd’hui, c’est de se préparer à agir quand ça arrive. Concrètement, cela suppose de la part des écoles de réfléchir collectivement à la question. Mais aussi de soigner le climat scolaire et la qualité relationnelle entre élèves et enseignant·es ; cibler des projets de prévention et les planifier dans le temps (accueil, parrainage des nouveaux/nouvelles, sensibilisation au harcèlement) ; définir des personnes en charge de l’intervention, former ces personnes et définir un protocole de signalement et de prise en charge ».
À LIRE AUSSI



