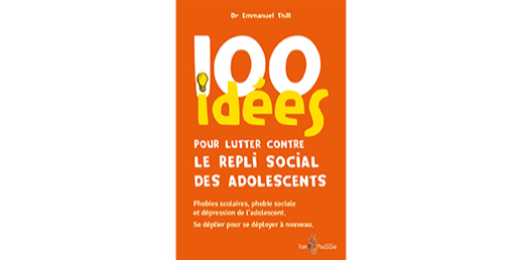Développement de l'enfant

Votre ado est devenu·e un·e jeune de 25 à 29 ans. Plus vraiment à l’école, mais pas encore sur le marché du travail. Incertitude financière oblige, il ou elle continue d’habiter sous votre toit. L’ambiance est parfois électrique, surtout lorsqu’on discute d’autonomie à acquérir, de job à décrocher. Comment encadrer, accompagner en toute sérénité ?
Véronique a 55 ans. Son « gamin », comme elle l’appelle encore, en affiche 26. Il y a un an, il a terminé ses études. Avec un peu de retard, de quoi terminer son cursus au-delà de 25 ans. Là, il a été confronté à une réalité, 25 ans, c’est l’âge limite pour prétendre à des allocations de chômage quand on termine ses études. Il découvre qu’être demandeur d’emploi, ce n’est pas forcément émarger au chômage. Le voilà donc chez papa et maman, de retour après trois ans de « kots » à Bruxelles.
Cette situation génère quelques frictions, notamment avec Benoît, le papa, qui est moins coulant que Véronique. La vie au quotidien, pour lui, peut vite se décliner en petites exaspérations, qui vont de l’énervement face à la vaisselle qui s’accumule jusqu’aux arrivées tardives de potes en fin de soirée. Mais derrière ces épiphénomènes, il y a cette crainte sur le futur d’Harold. D’entretiens en examens, le « gamin » essuie des échecs qui n’ont rien à voir avec les atermoiements scolaires. La confiance en lui s’érode. Et les parents ne trouvent pas toujours le bon bout pour le motiver.
« Je n’ai pas envie qu’il pense qu’on veut qu’il se dépêche de quitter la maison », confesse Véronique. Benoît, de son côté, a l’impression que tout ce qu’il dit n’a pas l’effet escompté. Les encouragements semblent se transformer en flops. Quant aux injonctions à se prendre en mains, ce n’est pas mieux, elles suscitent l’énervement d’Harold qui se referme alors comme une huître.
Un·e jeune sur trois concerné·e
À ce stade, un petit point pour rassurer Véronique et Benoît. Ils ne vivent pas une situation unique, loin de là. Leur réalité est partagée par de nombreux parents. En Belgique, en 2023, 32,4% des jeunes âgé·es de 25 à 29 ans vivaient toujours chez leurs parents. Avec une proportion plus élevée chez les garçons (39,9%) que chez les filles (24,6%). Ces chiffres sont en deçà de la moyenne européenne, tiraillée entre les pays scandinaves (Norvège, Suède, Finlande, Danemark) où les valeurs sont sous les 10% et des pays comme la Croatie, le Monténégro, la Grèce, la Slovaquie et l’Italie où les 70% sont dépassés.
Dans le dialogue, des phrases toutes faites à bannir, des bons moments à trouver
En Belgique donc, un·e jeune sur trois cohabiterait avec ses parents. La plupart du temps pour cause d’autonomie financière plombée par le coût du logement, l’expérience réclamée dans les offres d’emploi, les tarifs prohibitifs pour les assurances qui touchent les jeunes. « Il y a toute une série de bâtons qui sont mis dans les roues des jeunes », constate Sophie Maes, pédopsychiatre et thérapeute de famille. Celle-ci estime qu’il est important de prendre conscience du contexte général, « je pense que cette crispation qui survient entre les parents et leurs enfants devenus jeunes adultes vient surtout d’une dynamique sociétale qui déplace le problème sur les familles ».
Se rendre compte de cela, c’est déjà un pas, estime Sophie Maes, cela permet déjà de « se décaler un petit peu, de prendre du recul ». Au cœur de la relation parent/enfant, c’est une des choses qui doit être verbalisée. Car s’il n’y pas de « recette miracle », la thérapeute familiale insiste sur l’impérieuse nécessité de communiquer.
Les bons mots, le bon moment
Communiquer, d’accord. Mais comment ? Benoît exposait, il y a un instant, sa difficulté de dialogue avec son fils. Comment mettre de l’huile dans les rouages de la communication ? Commençons par la conversation en creux : quelles sont, par eempel, les petites phrases à éviter ? « De mon temps… », c’est ce qui vient tout de suite à l’esprit de Sophie Maes.
« Le parent doit pouvoir accepter que le monde du travail d’aujourd’hui ne corresponde pas à celui qu’il a rencontré dans sa jeunesse. On est dans quelque chose de beaucoup plus instable, plus insécurisant, plus mouvant. Plus que de réussites et d’échecs, il est question de capacité d’adaptation, de pouvoir rebondir. Il y a une ou deux générations, on pouvait encore imaginer rentrer dans une entreprise et y faire carrière. Maintenant, ce n’est plus le cas. Quelqu’un qui reste très longtemps au même endroit finit par en devenir suspect et jugé comme peu flexible ». Le fossé est grand, les sources d’incompréhension aussi. Le parent se voit dans l’obligation d’intégrer ce changement de paradigme.
Autre phrase à bannir : « T’as raté cette embauche-là ? Pas grave, comme on dit, une de perdue, dix de retrouvées ». Là, Sophie Maes insiste sur le fait qu’un échec peut aussi créer une blessure narcissique qu’il s’agit de reconnaître, comme toutes les émotions que traverse son ou sa jeune. « Prenons le découragement. Ce qui est important, c’est de se dire qu’on peut vivre des situations en étant découragé. C’est normal. Comme on a le droit d’être triste et déçu, pour autant que cette émotion ne s’inscrive pas trop dans la durée. Même si, parfois, ça peut prendre le temps de faire le deuil d’un poste dont on a rêvé et pour lequel on n’a pas été pris. Un côté dépressif ne peut passer que s’il a été reconnu et partagé, que si on a ménagé un temps pour l’exprimer ».
Nuance et équilibre sont les deux qualificatifs invoqués par Sophie Maes qui invite à proscrire les phrases toute faites derrière lesquelles se cachent toujours plus ou moins subtilement le piège de la performance à tout prix.
Reste le bon moment pour communiquer. Consels de base ? Verbaliser en dehors d’une crise, d’une dispute. « Il faut plutôt profiter de la réconciliation, de l’apaisement... En parler en période de crise ne risque que de déboucher sur des paroles qui ne vont refléter que l’émotion la plus forte et pas une réflexion poussée et posée. Il s’agit de laisser la tension redescendre, puis d’en rediscuter par la suite en n’ayant pas peur de réactiver les choses. Enterrer le sujet par peur de se disputer, c’est rentrer dans une zone de non-dit et de tabou qui serait pernicieuse à long terme ». Pour Véronique, ce moment c’est celui de la vaisselle. Pour Benoît, ce sont les trajets en voiture à deux. Pas de recette miracle. À chacun·e ses ingrédients et sa méthode.
ZOOM
Grands ados en quête d’identité professionnelle
En Wallonie, pour aider les jeunes à se trouver un chemin, il y a désormais « Coup de boost », un projet qui s’adresse aux 18-29 ans. Lancé en 2021 en partenariat avec le Forem, la CSC et la FGTB, il sera pérennisé à partir du 1er janvier de l’année prochaine. Il était en phase test, mais cette fois-ci son existence a été fixée dans un décret voté au Parlement wallon. Depuis son lancement, chaque année, plus ou moins 500 jeunes ont eu recours à ses services. Et la bonne nouvelle, c’est que dans 70% des cas, l’accompagnement s’est concrétisé par un emploi ou un aiguillage vers une formation qualifiante.
Le public cible ? Les jeunes et grand·es ados qui sont « très éloigné·es de l’emploi » selon les termes employés par Fabien Braeckevelt, chef de projet. Sont donc concerné·es en premier chef les jeunes en décrochage par rapport au monde du travail ou qui se retrouvent dans des situations précaires. « Coup de Boost » leur propose donc un accompagnement personnalisé.
Au final, l’idée est de renforcer la confiance et d’explorer les compétences, de choisir une orientation, un projet professionnel, d’être autonome dans les recherches d’emploi ou de formation. Le tout avec une dynamique collective où il s’agit de collaborer « de manière positive pour surmonter les défis ensemble ». Si le dispositif semble adapté aux besoins de votre enfant, n’hésitez pas à lui conseiller de participer à une des séances d’informations. Celles-ci sont répertoriées dans un agenda sur coupdeboost.be.
LE CHIFFRE
9,6%
C’est le nombre de 15-29 ans qui, en 2023, étaient sans travail et ne suivaient aucun enseignement ou formation. Ce pourcentage a un petit nom, c’est l’indicateur NEET, acronyme brinquebalant et anglicisant de young people Neither in Employment nor in Education or Training. Avec 13%, c’est la Wallonie qui a le taux de NEET le plus élevé en Belgique. Suivent Bruxelles avec 11,2% et la Flandre avec 7,3%.
À LIRE AUSSI